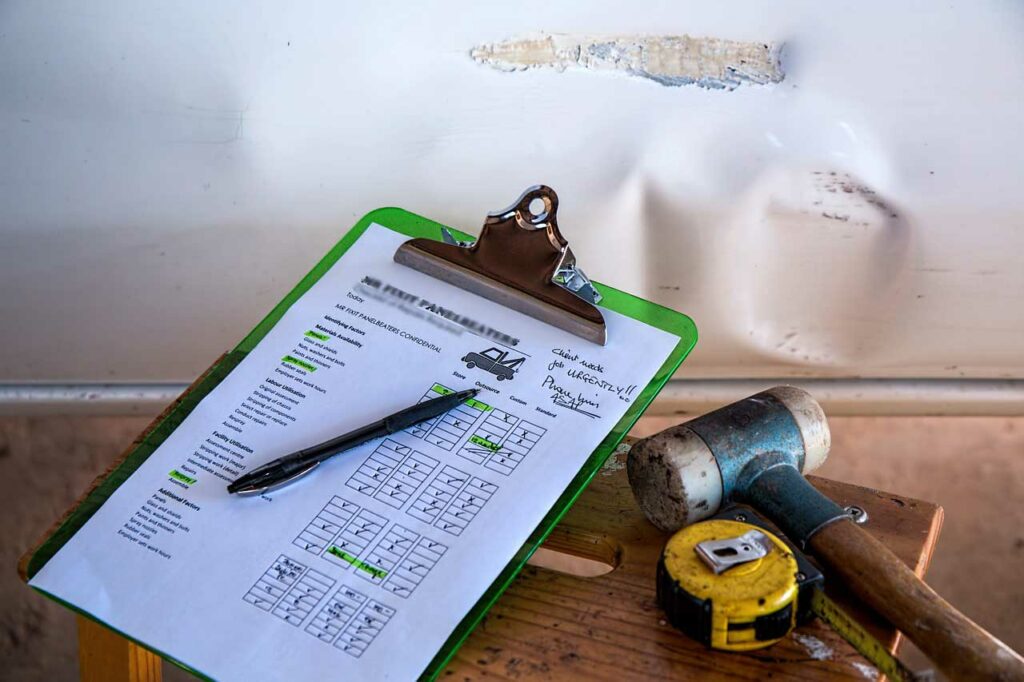Barème des accidents de travail en matière sociale – Cabinet d’Expertises Médicales Dr Dubois – Tours & Angers
Dans le cadre des accidents de travail, le taux d’incapacité permanente est défini par le Barème indicatif d’invalidité en Accidents de Travail. Le rôle du cabinet d’expertise du Dr Dubois consiste dans ce cas à évaluer de manière indépendante le taux d’incapacité de la victime.
Comme le présent barème n’est publié qu’à titre indicatif, le médecin expert se réserve l’entière liberté d’aller au-delà des chiffres du barème s’il rencontre des cas particuliers. Cependant il doit alors exposer clairement les motifs de sa décision.
Objectif du barème des accidents de travail
Le présent barème indicatif sert de base à l’estimation du préjudice résultant des séquelles des accidents de travail ou des maladies professionnelles des salariés du régime général et du régime agricole tel que décrit par l’article L. 434-2. Selon cet article, l’incapacité permanente est définie d’après :
1.- L’appréciation médicale de l’état du sujet:
- L’état général de la victime
- L’âge de la victime,
- La nature de l’infirmité,
- Ses facultés physiques et mentales,
2.- L’appréciation médico-sociale du médecin en charge de l’évaluation
- Ses aptitudes,
- Sa qualification professionnelle.
Au cas où les séquelles de l’accident ou la maladie professionnelle sont susceptibles de modifier la situation professionnelle de la victime, un changement d’emploi par exemple, le médecin expert doit mettre en exergue les facteurs susceptibles d’influer l’évaluation finale.
Rapport entre les lésions et séquelles
A noter que les séquelles d’un accident de travail ne se rapportent pas nécessairement à l’importance des lésions initiales. Celles-ci peuvent être minimes au départ mais pourraient causer des séquelles importantes. A l’inverse, les lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles infimes voire finir par guérir.
La consolidation
Après la période de soins, la consolidation reste la période de stabilisation finale à partir de laquelle la lésion prend un caractère définitif et que les soins ne sont susceptibles d’entraîner de modification de l’état séquellaire ; ils ne sont alors plus nécessaires sauf pour des traitements d’entretien. A partir de la consolidation, il est possible d’apprécier l’incapacité permanente après l’accident de travail s’il n’y a plus de rechute ou de révisions.
La consolidation ne veut pas nécessairement signifier reprise d’activité professionnelle, les séquelles peuvent l’empêcher ou dans d’autres cas, la reprise de la vie professionnelle se fait parallèlement à la poursuite des soins pendant un temps suffisamment long jusqu’à ce que les séquelles soient fixées, d’où la confirmation de la consolidation. La reprise du travail peut se faire sur un poste adapté et/ou à temps définitivement partiel.
Disposition en cas de guérison
D’après l’article L.433-1 de la Sécurité sociale, le maintien de l’indemnité journalière est autorisé en cas de reprise d’un travail léger qui favorise la consolidation voire la guérison des blessures. Par contre, dans le cas de la guérison avec absence de séquelle fonctionnelle, il n’y aura pas d’incapacité permanente. S’il constate que la guérison est acquise, le médecin expert ne peut plus proposer un taux médical d’incapacité permanente.
Il est toutefois envisageable qu’à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie d’origine professionnelle, un changement de profession soit inévitable. Cela permet de :
- Rendre la guérison valable,
- Réparer le préjudice qui résulte de l’inaptitude causé par les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle en question.
Calcul du taux médical d’incapacité
Le médecin en charge de l’évaluation explique en détail dans ses conclusions les raisons qui conduisent à ce changement de profession, entre autres :
- Les séquelles dues aux lésions isolées
- Les infirmités multiples dues au même accident
- Les infirmités antérieures
Les séquelles dues aux lésions isolées
C’est à partir du taux moyen proposé par le barème des accidents de travail que ces séquelles sont appréciées. Le barème sera adapté en fonction de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales.
Les infirmités multiples dues au même accident
Les infirmités multiples concernent les membres ou des organes différents. Au cas où les lésions localisées sur des membres différents se portent sur une même fonction, les taux estimés doivent s’additionner sauf pour des cas précis figurant dans le barème.
Pour des infirmités multiples qui ne portent pas sur une même fonction, l’une des incapacités doit être estimée en premier. Le taux de la capacité totale sera fixé à 100, ce qui permet d’évaluer la capacité restante.
Si le barème ne prévoit aucun cas particulier, l’infirmité suivante sera estimée elle-même avant d’être rapportée à la capacité restante. Ainsi, on obtient le taux qui correspond à la deuxième séquelle. Suivant ce calcul, la somme des deux taux donne l’incapacité globale. Cette dernière restera identique, même si la prise en compte des infirmités ne respecte pas l’ordre. A titre d’exemple :
- Une lésion X a causé une incapacité de 60%, la capacité restante est donc de 40%,
- Une lésion Y consécutive au même accident a causé une incapacité de 20% (selon une estimation chiffrable du barème), l’incapacité due pour cette deuxième lésion est donc de 20% des 40% de la capacité restante, ce qui donne 8%.
- Au final, l’incapacité globale est donc de 60% + 8% = 68% et ainsi de suite,
S’il y a une troisième lésion, elle devra s’apprécier à partir de la capacité restante de 32%. Ce mode de calcul de l’incapacité globale causée par de multiples lésions reste indicatif. Le médecin expert en charge de l’évaluation se réserve le droit de la modifier, il peut opter pour un autre mode de calcul en y apportant des raisons de son choix.
Cette règle des incapacités multiples est appelée « règle de Balthazar ».
Les infirmités antérieures
L’évaluation médicale de l’incapacité doit distinguer la partie de l’état antérieur de ce qui est relatif à l’accident. Seules les séquelles imputables à l’accident sont en principe indemnisables. Cela n’empêche pas d’autres actions réciproques nécessitant une considération particulière :
- il est possible que l’accident de travail ou la maladie professionnelle ait fait réapparaître un état pathologique antérieur, sans toutefois qu’il soit aggravé par les séquelles. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de l’inclure dans l’estimation de l’incapacité.
- Dans le cas où l’accident de travail ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état antérieur pathologique, seule l’aggravation due au traumatisme reste totalement indemnisable. Cette part d’aggravation est imputable, c’est la notion fondamentale d’imputabilité.
- Si l’accident vient aggraver un état pathologique connu avant l’accident, il y a lieu d’en faire une estimation.
https://www.youtube.com/watch?v=WNdKLuugoeQ
Vidéo : Comprendre l’accident de travail : conditions et indemnisation